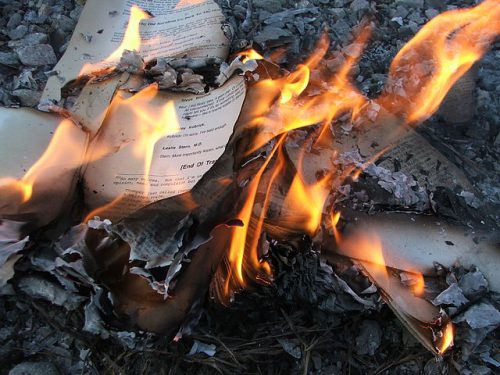
La Haine de la littérature (Jan Baetens)
William Marx en 2015 : la rhétorique, encore et toujours ?
Jan Baetens (Université de Leuven, MDRN/Belspo), contribution au débat sur William Marx, La Haine de la littérature (Paris : Minuit, 2015), à paraître dans n° 4 de Romanische Studien (2016)
Cette recherche a été financée par la Politique scientifique fédérale au titre du Programme Pôles d’attraction interuniversitaires, voir LMI/Literature and Media Innovation, PAI: http://lmi.arts.kuleuven.be.
Dix ans séparent L’Adieu à la littérature (2005) de La Haine de la littérature (2015), mais c’est bien comme un livre en deux tomes qu’il convient de lire ces textes. Certes, le ton a changé, crépusculaire dans le premier volet du diptyque, résolument volontariste dans le second, qui excède l’adage gramscien : « pessimisme de l’intelligence, optimisme de la volonté ». La perspective s’est modifiée aussi : L’Adieu à la littérature voulait précipiter une prise de conscience des dangers du nombrilisme formaliste, La Haine de la littérature est une vigoureuse défense de la chose littéraire contre tous les reproches qui lui sont adressés depuis la nuit des temps.
La Haine de la littérature est la synthèse parfaite des récents débats en la matière. Une question qui touche à l’essentiel : non pas la sartrienne « qu’est-ce que la littérature ? », mais « pourquoi la littérature ? » (et toute la littérature – pas seulement la prose de propagande de Jean-Paul Sartre). Un style digne de son objet : mordant, rapide, mais aussi léger et d’une réelle élégance. Une méthodologie à la hauteur des enjeux : au lieu de l’énième énumération des raisons qui devraient nous faire aimer malgré tout la littérature (la bonne cause du jour, que défend encore une toute petite ONG), l’examen critique des arguments de toux ceux qui, de Platon au président de l’ex-UMP, ne pensent qu’à chasser les poètes de la cité (ou des guichets de la poste).
À la publication d’Adieu à la littérature, on a reproché à William Marx une forme de défaitisme. C’était l’effet d’une non-lecture. Le livre ne disait nullement que les temps de la littérature étaient révolus, il exprimait le souhait violent que la littérature puisse retrouver la place qui n’est plus, hélas, la sienne. Dix ans plus tard, le message reste le même, mais l’auteur adopte ici une stratégie différente, moins défensive, qui attaque frontalement les ennemis de la littérature. Pour William Marx, la haine de la littérature n’est pas le privilège de tel ou tel groupe social. Textes en main, il démontre que la littérature a toujours dérangé la pensée au pouvoir – aujourd’hui celle qui s’étale tranquillement parmi ceux qui veulent également transformer les sciences humaines en sciences de la communication et du marketing confondus et pour qui la Princesse de Clèves, l’histoire du sonnet ou Jacques Derrida sont devenus intolérables.
Ce qui subsiste – entre L’Adieu et La Haine – est le souci de dépasser le point de point franco-français du débat. Pendant de l’exceptionnelle érudition de William Marx, cette ouverture à l’international n’a rien à voir avec la mode actuelle de la « littérature mondiale » (Moretti, « Conjectures on World Literature ».) ou du « French global » (McDonald et Suleiman, Global French), moins encore avec les dérives d’un vide abyssal qu’on trouve sous la plume de Susan Stanford Friedman sur le « modernisme planétaire » (Friedman, Planetary Modernisms). La démarche de William Marx est à la fois plus traditionnelle et plus ambitieuse ; elle est surtout solidement enracinée dans les textes et dans l’histoire. Dans son travail, Marx s’appuie sur la confrontation des deux grandes approches ou méthodologies, la française et l’anglo-saxonne, qui continuent à dominer le commerce des textes, dans tous les sens du terme. Le dossier de Samuel Beckett, si brillamment instruit dans l’épilogue de L’Adieu à la littérature, en avait fourni déjà un exemple, l’écriture de Beckett étant vu par les Français comme une condamnation sans rémission possible de toute forme d’expression littéraire à l’époque contemporaine, là où les Anglo-Saxons se sont toujours montrés sensibles à l’humour et partant à l’espoir de son ses expériences. Comme lui-même le résumé : « Les Français virent dans l’œuvre de Beckett un langage gagné par la ruine ; les Anglo-Saxons, un langage qui gagnait sur la ruine. Pour les uns, le néant malgré l’ouvre ; pour les autres, l’œuvre malgré le néant. » (Marx, L’Adieu à la littérature, 176.) Dans La Haine de la littérature, le dialogue transatlantique est plus prononcé encore et il conduit à quelques nouvelles mises en question qui seront au cœur des pages qui suivent.
L’Adieu à la littérature avait souligné déjà l’apport décisif des études culturelles à la dévalorisation de l’écriture littérature. Marx y insistait avec des mots très durs qu’on pouvait s’étonner de retrouver sous sa plume, tant ils rappelaient certaines ukases d’Alain Finkielkraut, rendues tristement célèbres par certains passages de La Défaite de la pensée où il est suggéré qu’on met désormais au même niveau Shakespeare et Tintin. L’objet du travail de William Marx n’étant pas les études culturelles, on ne discutera pas ici ces allégations un peu rapides, dont La Haine de la littérature offre déjà une présentation infiniment plus nuancée – et par moments tout à fait positive. En effet, dans la défense de la littérature, la réinterprétation du rôle des cultural studies occupe une place stratégique.
Pour opérer ce changement, Marx fait un retour aux sources, à la fois celles des études cultures en Angleterre et celles de leur réception en France. S’agissant des pionniers britanniques, Richard Hoggart et Raymond Williams, Marx rappelle utilement, contre la doxa largement répandue dans les départements d’études culturelles mêmes, l’attachement de ces auteurs à la grande littérature et leurs efforts de la transmettre à de nouveaux publics, moins culturellement privilégiés que l’élite cherchant à se distinguer à l’aide de ses goûts littéraires. En ce qui concerne la traduction du premier livre de Hoggart (Hoggart, Uses of Literacy), il dénonce aussi bien la traduction tendancieuse du titre (Hoggart, La Culture du pauvre) que le détournement des études culturelles par la sociologie littérature à la Bourdieu. Ce dernier refusait de voir en la littérature autre chose qu’un instrument de discrimination et de domination sociale, mais s’avérait incapable de proposer de nouvelles formes d’enseignement du texte littéraire, privé chez lui de tout contenu et de toute forme.
Ce retour sur les cultural studies est salutaire, car il déconstruit un des arguments contemporains les plus violents contre la littérature, à savoir son incapacité à parler du réel, puis à intervenir dans les débats sociétaux en cours. Il aide aussi à arracher les études culturelles à la mainmise des spécialistes des médias et sciences de la communication, d’autant plus rapides à rejeter la littérature qu’ils sont les derniers à vraiment lire les textes mêmes.
À ce propos, deux précisions sont toutefois utiles à faire. La première concerne les lectures sociologisantes des faits littératures dans la lignée de Bourdieu. William Marx a l’élégance de mentionner l’estime sincère de Bourdieu pour les grands écrivains du passé. On pourrait y ajouter que certains de ses élèves, mais moins sans doute en France qu’en Belgique (et, espérons-le, en d’autres pays), parviennent mieux à réconcilier les points de vue sociologique et littéraire (On citera ici en guise d’exemples Durand, Mallarmé et Dubois, Pour Albertine). La seconde remarque, qui va dans le même sens, concerne les décalages entre, d’un côté, la réception, plus exactement la non-réception, des études culturelles en France et, de l’autre, l’interprétation plus libre donnée au paradigme des cultural studies en d’autres pays européens, où la tension entre approche littéraire et approche culturelle a été vécue de façon moins antagoniste (Pour un exemple de pareil œcuménisme, voir Baetens, « Une défense ‘culturelle’ des études littéraires »).
L’emprise des études culturelles, tant par sa diffusion dans le monde académique anglo-saxon que par sa réception biaisée en France, désigne l’enseignement comme le facteur clé des débats actuels sur la littérature, voire des procès qui lui sont intentés. La crise actuelle de la littérature, c’est-à-dire la dégradation du rôle social qu’on lui laisse encore jouer, est à bien des égards une crise de l’enseignement, qui soit refuse de maintenir la littérature aux programmes, soit n’est plus à même de transmettre le goût des textes aux élèves –ceci renforçant cela, bien entendu, et inversement.
De cet échec, le diagnostic n’est pas neuf, mais les remèdes qu’on cherche à y apporter ont du mal à prendre forme. Comme le suggère le déplacement du centre de gravité de L’Adieu à la littérature à La Haine de la littérature, la question essentielle n’est plus la défense et illustration de la littérature « en soi », mais la meilleure manière de faire face aux attaques dont elle est la victime presque consentante.
À cet égard, trois stratégies, qui ne sont pas toutes discutées en détail par William Marx, méritent d’être signalées. D’abord, l’intérêt renouvelé pour le plaisir de lecture, au sens très simple et quasi banal du terme, qui inclut aussi le plaisir, longtemps jugé coupable, qu’on prend à des textes « lisibles » – et non plus seulement « scriptibles » (Barthes, S/Z). Le livre de Jean-Marie Schaeffer, qu’on peut difficilement soupçonner de populisme, a des positions très courageuses sur ce point, par exemple (Schaeffer, Petite écologie des études littéraires).
En second lieu, le retour à ce qui s’est tragiquement retrouvé à l’écart des études littéraires modernes, à savoir la stylistique, héritière de l’enseignement rhétorique traditionnel. L’oubli de la rhétorique, sans doute la seule approche littéraire à même de faire coïncider production et réception des textes, a rejeté l’étude du style (entendez : l’analyse des mots et des phrases, essentiellement) comme survivance d’un passé qui n’a plus lieu d’être. Aujourd’hui, cette stylistique est en train de faire un retour en force, grâce entre autres aux recherches de Gilles Philippe, proposant une lecture à la fois historique et contextuelle de la notion de style (Philippe et Piat, La langue littéraire et Philippe, Le Rêve du style parfait). Pour ce faire, Philippe et d’autres combinent microscopie grammaticale et analyse du style comme imaginaire social. À l’époque du « distant reading » et des illusions « scientifiques » entretenues par cette méthode rigoureusement anti-stylistique, car indifférente à la lettre du texte, la néo-stylistique signifie une évolution capitale qu’il convient de saluer haut et fort.
Troisièmement, enfin, la prise au sérieux des techniques d’apprentissage, non pas de la lecture, mais de l’écriture. À l’instar des campagne d’alphabétisation, où l’on a pu constater que le succès de l’apprentissage de la lecture est fonction de l’apprentissage parallèle de l’écriture (Petrucci, Scrivere e no), l’orientation sur la lecture ne peut plus être dissociée du poids donné à l’écriture. Chacun à sa façon, les modèles français et américain retrouvent sur ce point le socle et l’horizon de l’ancienne rhétorique. Les Français avec les ateliers d’écriture à base de contraintes plus ou moins oulipiennes, les Américains avec les cours de « creative writing » fondés sur la croyance en l’expérience personnelle de l’auteur en herbe. On s’abstiendra ici de faire des jugements de valeur sur les mérites respectifs de ces deux approches ou philosophies, similaires quant à leurs principes de base (l’écriture n’est pas un don, elle est quelque chose qui s’apprend) et différentes quant à leurs méthodologies (plus libres, du moins en apparence, dans le modèle américain, plus dirigées, pense-t-on, du côté français). L’important, ici, est de signaler combien l’inclusion d’un « souci de faire » a changé notre idée de la littérature. Tout comme le musée imaginaire d’André Malraux a révolutionné la définition de l’art par son recours privilégié à la reproduction photographique (Malraux, Les Voix du silence) – l’art devient ce qui est photographiable ; le rapport entre ensemble et détail est bouleversé suite à l’indépendance prise par le détail rendu visible par la photographie ; l’unicité de l’œuvre se dissout à cause des comparaisons rendues possibles par la circulation des images, etc. –, le rapprochement de la lecture (objet traditionnel des méthodes littéraires après l’ère rhétorique) et de l’écriture (objet mystérieux longtemps exclu de l’enseignement formel, sauf dans des buts professionnels : journalisme, communication, etc.) a transformé ce que nous appelons littérature. Dans un ouvrage fondamental sur l’histoire des programmes de « creative writing », Mark McGurl a montré le lien étroit entre l’ouverture du curriculum universitaire à ce type d’enseignement et l’apparition d’un nouveau canon, plus approprié aux attentes et aux nécessités des étudiants désireux d’apprendre à écrire, quitte à en faire leur profession (McGurl, The Program Era). Il y a fort à parier que des évolutions comparables sont en train de se produire en France aussi, suite à la diffusion des ateliers d’écriture dans les études supérieures.
L’enseignement de la littérature ne peut toutefois être réduit au seul enseignement scolaire. Un des grands défis pour les années à venir sera sûrement l’effort de réconcilier l’enseignement officiel, où la littérature a du plomb dans l’aile, et les mille et une initiatives, florissantes mais parfois un rien sauvages, de l’enseignement littéraire informel. Car où apprend-on aujourd’hui la littérature ? À l’école, certes, mais de moins en moins. Il faut penser davantage aux cercles de lecture, aux blogs, au cinéma, aux manuels de toutes sortes, à la télévision … Dans Bring on the Books for Everybody, allusion transparente au club de livres animé par la célèbre Oprah Winfrey, Jim Collins a investigué la manière dont le public se réapproprie une pratique – la littérature – dont l’enseignement traditionnel, coupé des réalités sociales, lui paraît décevant, si ce n’est trompeur. L’opposition radicale de la littérature telle qu’on l’enseigne stérilement à l’école et le dynamisme étonnant de l’auto-apprentissage, certes accompagné ou relayé par des entreprises commerciales, n’a évidemment rien d’absolu. L’étude de Collins, qui décrit avec un enthousiasme contagieux comment la littérature retrouve sa place dans la vie de tous les jours, n’est en aucune façon un plaidoyer pour l’abandon de la littérature dans l’enseignement scolaire. Elle veut nous encourager à repenser cet enseignement. En ce sens, les analyses de Bring on the Books for Everybody ne sont nullement incompatibles avec celles de La Haine de la littérature.
Il faut cesser de se demander pourquoi enseigner la littérature. Ce qu’il importe de savoir, c’est comment on peut le faire. En bonne rhétorique, on sait que les effets s’ensuivront tout seuls : la pratique est performative, elle produit elle-même sa propre source.
Sources citées
- Baetens, Jan. « Une défense ‘culturelle’ des études littéraires », LHT/Fabula 8 (2011), en ligne : www.fabula.org/lht/8/baetens.html, dernière visite: 10 octobre 2015.
- Barthes, Roland. S/Z. Paris : Seuil, 1970.
- Collins, Jim. Bring On the Books for Everybody: How Literary Culture Became Popular Culture. Chapel Hill : Duke University Press, 2010.
- Dubois, Jacques. Pour Albertine: Proust et le sens du social. Paris : Seuil, 1997.
- Durand, Pascal. Mallarmé: du sens des formes au sens des formalités. Paris : Seuil, 2008.
- Finkielkraut, Alain. La Défaite de la pensée. Paris : Gallimard, 1987.
- Friedman, Susan Stanford. Planetary Modernisms: Provocations on Modernity Across Time. New York : Columbia University Press, 2015.
- Hoggart, Richard. Uses of Literacy: Aspects of Working Class Life. Harmondsworth : Penguin Books, 1957.
- ———. La Culture du pauvre. Paris : Minuit, 1975 [1957].
- Malraux, André. Les Voix du silence. Paris : Gallimard, 1951.
- Marx, William. L’Adieu à la littérature. Paris : Minuit, 2005.
- ———. La Haine de la littérature. Paris : Minuit, 2015.
- McDonald, Christie et Susan Rubin Suleiman, dir. Global French: A New Approach to Literary History. New York : Columbia University Press, 2011.
- McGurl, Mark. The Program Era: Postwar Fiction and the Rise of Creative Writing. Cambridge : Harvard University Press, 2010.
- Moretti, Franco. “Conjectures on World Literature.” New Left Review 1 (2000): 54–68.
- Petrucci, Armando. Scrivere e no: politiche della scrittura e analfabetismo nel mondo d’oggi. Rome : Editori Riuniti, 1987.
- Philippe, Gilles. Le Rêve du style parfait. Paris : PUF, 2013.
- ——— et Julien Piat, dir. La langue littéraire : une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à Claude Simon, Paris : Fayard, 2009.
- Schaeffer, Jean-Marie. Petite écologie des études littéraires : pourquoi et comment étudier la littérature ? Paris : éd. Thierry Marchaisse, 2011.